|
Didactique (Rizzo), cours
n°4 :
le 02/04/03
1 à 4 mois : coordination des mouvements => réactions circulaires
primaires
Les réactions circulaires secondaires ne concernent plus uniquement
l'enfant mais les objets qui l'entourent.
Pour Piaget, on n'est pas face à un acte d'intelligence car le
résultat obtenu la 1ère fois c'est fait par hasard.
Pour l'intelligence, il faut que le 1er acte soit intentionnel.
La pensée de l'enfant est égocentrique car l'enfant ne fait de
différence entre le moi et autrui.
Le fait à commencer les objets qui les entourent permet le début de
la décentration.
Notion de permanence de l'objet, pas encore à 6 mois
Entre 9 et 12 mois, l'enfant ne se contente plus de reproduire des
résultats intéressants, il se propose d'atteindre des buts
non-directement accessible.
Acte de prendre la main était une fin en soi avant et maintenant
prendre la main et l'écarter est un moyen.
On assiste là à de l'intentionnalité, le 1er acte d'intelligence.
Pour Piaget, on est intelligent à partir du moment où on agit sur son
environnement pour pouvoir s'y adapter
Entre 12 et 18 mois, l'enfant ne répète plus des mouvements connus
mais va graduer ces mouvements.
IL gradue ces mouvements, les modifie dans le but d'en étudier la nature
: conquête du monde notamment grâce à la marche.
Le principe d'accommodation est une accommodation pour elle-même pas
pour s'adapter mais pour faire d'autres expériences.
Entre 18 et 24 mois : fin de la période
sensori-motrice, émergence de
la fonction symbolique. Elle permet d'élargir son champ de pensée.
Les expériences ne se passent plus seulement au niveau pratique mais
aussi au niveau mental.
Quand on arrive au 1er stade, il y a basculement à la 2ème phase.
Période des opérations concrètes :
Périodes préopératoire caractérisée par l'installation de la
fonction symbolique dans toutes ses dimensions.
ex : 200 mots à 2000 mots => enrichissement du vocabulaire.
"je" symbolique : il faut que l'enfant dispose de secteurs
d'activité dont la motivation n'a pas de lien avec l'adaptation réelle
mais c'est plutôt l'assimilation du réel à soi, il faut que le réel
s'adapte à lui.
Période opératoire de 7 à 12 ans :
Capacité de représenter un objet initial
- conservation
- sériation : comprendre qu'un élément est à la fois plus petit qu'un
élément X et plus grand qu'un élément Y.
Piaget référentiel exocentré en place vers 8-9ans.
Période de opérations formelles :
pensée intellectuelle
pensée hypothético-déductive
pensée abstraite
Fonctionnement des stades
Critères de définition des stades :
- Le développement de l'enfant s'effectue par stades successifs,
l'enfant traverse ces stades dans l'ordre et ne peut pas en sauter un.
- Les âges indiqués servent de repères souples (pas des données
rigides, ni des normes à atteindre)
Le milieu social peut en effet accélérer ou retarder l'apparition
d'u stade même en empêcher la manifestation.
- Il ne faut pas avoir l'idée d'une ligne, les stades ne se succèdent
pas de façon linéaire
- Les stades ont un caractère intégratif, il faut passer par un
stade pour en atteindre un autre.
Piaget : l'enfant doit parvenir à une maturité cognitive sans que les
parents ou les enseignants n'aient à jouer un grand rôle dans ce
processus. Le cerveau se développe dans un programme préétabli.
L'apprentissage n'a que peu d'importance, le cerveau aura de maintes
possibles, il ne faut pas pousser l'enfant.
Pourtant Piaget cherchait à influencer la pratique pédagogique et
convaincre les autorités éducatives de la valeur de l'action.
L'apprentissage doit se calquer sur le développement cognitif de
l'enfant, d'où l'intérêt de mettre l'enfant au centre du système
éducatif.
Vygotski : socio-constructivisme
Il met l'accent sur l'origine sociale du développement cognitif, il y
a 2 phases, 2 formes de fonctionnement mental.
- Processus mentaux élémentaire de 0 à 2 ans :
Il correspond au stade de l'intelligence sensori-motrice de Piaget, il
en attribue la provenance comme Piaget au capital génétique de
l'espèce, maturation biologique et surtout à l'expérience de
l'enfant dans son environnement.
- Processus mentaux supérieurs, plus de 2 ans :
Attention, mémoire, pensée verbale, autrement dit tout ce qui se
développe à partir de la mise en place de la fonction symbolique.
Les processus mentaux supérieurs reposent sur 3 points fondamentaux
(cf aussi le tableau) :
- Rapport entre éducation, apprentissage et développement cognitif
:
Idée que le développement cognitif de l'enfant est à considérer
comme une conséquence aux apprentissages.
Pour étudier le développement cognitif, il faut nécessairement
passer par une analyse des situations sociales.
Piaget reconnaît ces facteurs sociaux mais Vygotski dit que les
facteurs sociaux sont le point départ des apprentissages.
|
Processus d'apprentissage |
| Piaget |
Vigotski |
| modèles explicatifs binaires : interactions
individu-objet |
modèles explicatifs ternaires : interactions
individu-objet et le contexte social. |
| Point de différence :
dépendance ou indépendance entre le développement et
l'apprentissage. |
| C'est l'apprentissage qui est tributaire du
développement cognitif |
Il ne peut pas y avoir de développement cognitif sans
apprentissage.
Tout acte d'apprentissage e doit pas viser le niveau actuel du sujet
mais le niveau potentiel de ce dernier
niveau actuel : enfant capable de faire seul
niveau potentiel : situation avec médiation humaine qui l'aideront
au niveau cognitif
Le médiateur fait une radiographie de la tâche à accomplir
afin d'anticiper les difficultés que le sujet pourrait avoir. |
| Nature des processus
mentaux supérieurs |
| |
Passage de processus mentaux élémentaires à
supérieurs, c'est le langage, l'appropriation des instruments
relevant de l'héritage socioculturel. |
|
Passage de l'inter-psychique vers
l'intra-psychique |
| |
Chaque fonction supérieure apparaît 2 fois au cours
du développement de l'enfant.
Il se manifeste d'abord dans les activités collectives soutenues
par l'adulte et le groupe social.
Puis apparaît ensuite lors d'une activité individuelle et devient
alors une propriété intériorisée de la pensée de l'enfant.
ex : langage |
=> conflit socio-cognitif :
L'environnement social n'est plus vu comme un facteur qui influence le
développement individuel mais ce par quoi l'enfant devient Homme.
Les styles cognitifs
Ils relèvent de la pédagogie différentielle, ce sont à la fois des
aptitudes et des traits de personnalité. Face à une situation, un sujet
a tendance à utiliser un mode de pensée préférentiel qui correspond à
sa personnalité et ses aptitudes.
Les styles cognitifs peuvent se regrouper, cela dépend de la
diversité intellectuelles des chercheurs.
=>champ : toute information qui vient de l'extérieur.
- Dépendance - indépendance à l'égard du champ :
| Dépendance du champ |
Indépendance du champ |
| Tendance à faire confiance aux informations d'origine
externe |
Tendance à faire confiance aux repères personnels
d'origine interne |
| Attitude extravertie, accordant de l'importance au
contexte social et affectif de l'apprentissage : "cognition
chaude" |
Attitude introvertie, conduisant à des apprentissages
plus personnels et distanciés : "cognition chaude" |
| Restitution des données telles qu'elles ont été
proposées |
Reformulation (restructuration) personnelle des
données qui ont été fournies. |
| Besoin d'un définition extérieur des buts, des
objectifs |
Auto-définition possibles des buts, des objectifs |
| Intelligence relationnelle sociale |
|
- Réflexion - impulsivité :
Jeux de mémorisation : Les réfléchis prennent leur temps
Les impulsifs procèdent par essais-erreurs, ils répondent tout de suite. Les
enseignants ont de plus en plus des enfants impulsifs. En termes de
pédagogie, il faut résoudre le paradoxe qui consiste à s'appuyer sur la
dominante pour rassurer l'élève tout en cherchant à augmenter la
dominante complémentaire.
Pour les réflexifs, réfléchis : il faut
démocratiser l'erreur et pour les impulsifs, il faut donner plus de temps
pour réfléchir.
- Pensée latérale :
E. Bono la pensée latérale est de voir les choses autrement qu'avec
le regard usuel.
- Mode d'évocation visuel-Mode d'évocation auditif :
A. de la Garanderie fait le reproche de trop d'observation, trop
empirique.
(La gestion mentale en question, C. Cardou, 1995)
Chaque individu possède des habitudes évocatives qui lui sont
propres.
Evocation :
- façon de conserver l'information
- acte par lequel cessant de percevoir un objet ou un son, nous nous
donnons une représentation de l'objet ou du son perçu.
Perception : vue, ouie, odorat, toucher, goût
Perception => Evocation : images mentales visuelles ou auditives
On perçoit par les sens avec les stimuli, évoquer c'est redonner l'image
du stimulus qui n'est plus là.
3 : néo-cortex : traite l'information
1 : cerveau primaire : cerveau reptilien : survie, défense du territoire,
mimétisme
2 : cerveau limbique : relationnel, mémoire, émotion
4 types de phases
P1 : Auditive directe :
choses du quotidien : important en maternel
P2 : Auto-auditive :
évocation de mots, chiffre, par coeur => école primaire
P3 : Auto-visuelle :
évocation des principes, des relations => secondaire : logique, esprit
de synthèse
P3 : visuelle :
Imagination, créativité Polys : 
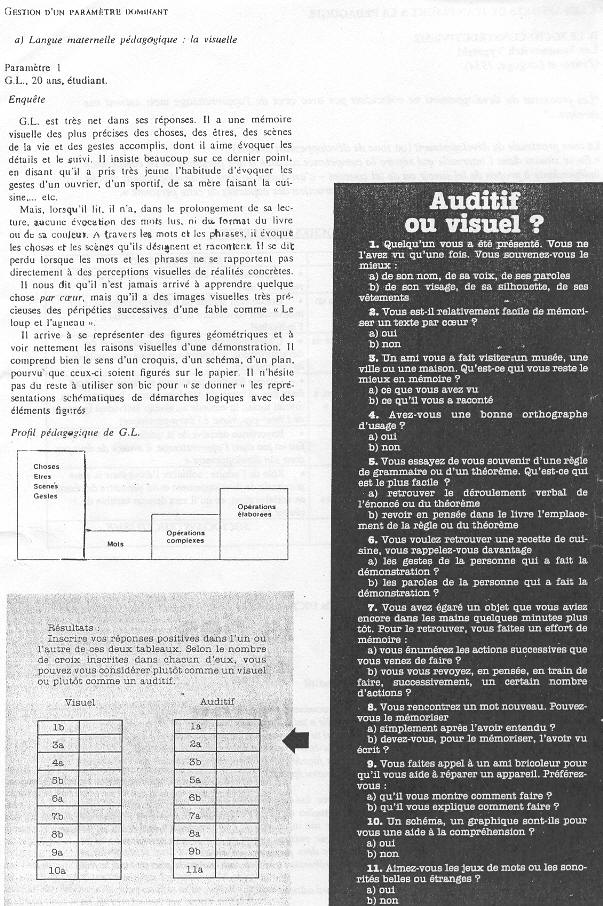
|



